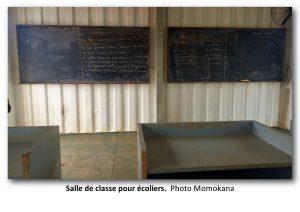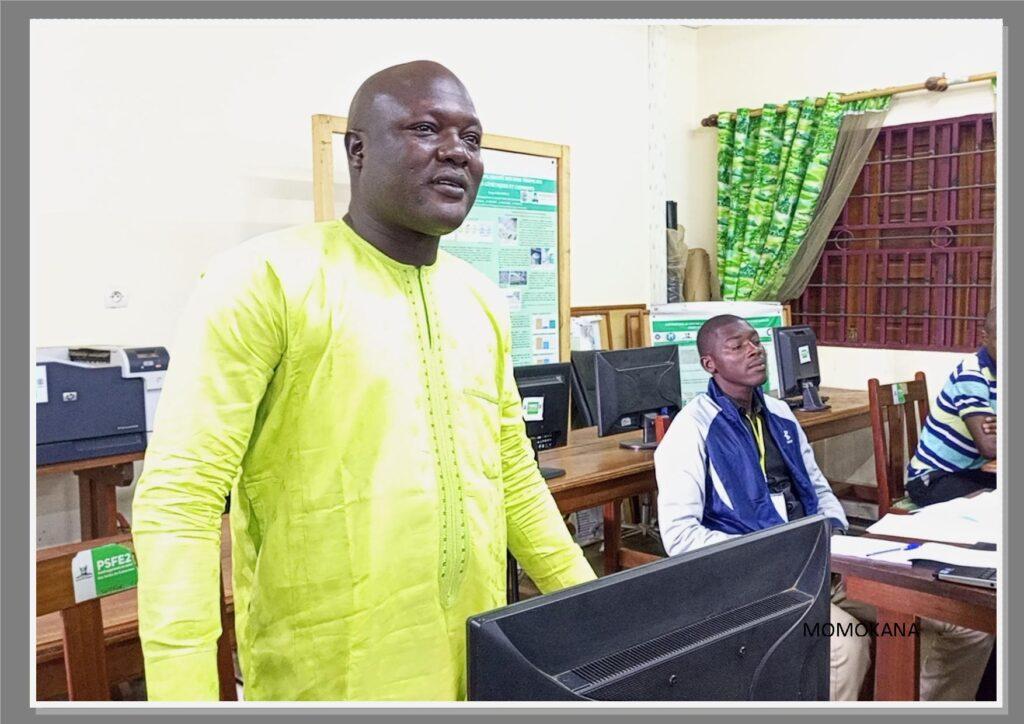
Docteur DANBOYA Emmanuel est le conservateur du Parc National de Waza. Sinotables s’est entretenu avec lui lors de l’atelier de formation des formateurs sur la résilience des communautés locales des parcs nationaux au changement climatique.
Rappelons que le Parc national de Waza est situé dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Il est une des meilleures vitrines naturelles du pays.
Quels sont les enjeux de l’atelier de formation des formateurs pour l’avenir des communautés locales riveraines du parc national de Waza ?
Il faut dire, en réalité, que cet atelier vient à point nommé. Parce que les populations qui vivent autour du parc de Waza ont besoin d’utiliser les ressources naturelles telles que le bois de chauffe, et même les poissons. Or la formation est axée sur le bambou de Chine. Alors, comment entreprendre une plantation de bambou, comment réussir son business plan. Cela dit, la formation pourra apporter une bouffée d’oxygène en ce sens qu’à travers leurs plantations les populations vont non seulement améliorer leur standard de vie, mais aussi elles vont contribuer à stopper l’érosion des sols qui est un véritable casse-tête dans cette partie du pays. Également elles vont reforester les zones déboisées et le bambou de Chine est approprié pour cette entreprise.
Quels sont les différents usages possibles du bambou de Chine dans la zone de Waza ?
Peu importe qu’on soit à Waza, à Dschang ou à Kimbi-Fungom, il existe globalement une multitude d’usages du bambou de Chine. Il y a d’abord que le bambou de Chine est utilisé pour la charpente. Chez-nous, dans le Nord, les gens utilisent les piquets pour faire la charpente. Vous voyez que le bambou de Chine va diminuer l’exploitation du bois d’œuvre et du bois de chauffe.
Parlez-vous de la dégradation des sols au niveau du parc national de Waza ?
Vous le savez, l’Extrême-Nord est une zone de steppes. Les arbres sont rares. Mais dans la partie sud on enregistre quelques végétations à l’instar de la savane arborée, de la savane arbustive. Néanmoins la demande en ressources végétales fait qu’il y a une pression énorme sur les quelques lignées disséminées dans cet environnement. Ainsi on assiste à une dégradation qui peut-être éolienne, pluviométrie parce que le sol est exposé à telle enseigne que la moindre eau qui ruisselle emporte les matières végétales et par conséquent la matière organique, et même humaine.
Vous voulez dire que de toutes les espèces végétales le bambou de Chine est l’espèce jugée appropriée pour régler ce phénomène ?
Je dirai que le bambou est approprié certes, mais il y a des espèces plus appropriées que le bambou de Chine. Je fais allusion aux espèces locales dont les acacias. Mais sauf que le bambou a des avantages que les autres n’ont pas. Il est à usages multiples. Avec le bambou de Chine on peut fabriquer le charbon. A cause de cette multiplicité d’usages on a pensé qu’il est bien que l’on adopte le bambou de Chine.
Ceux qui bénéficient de cette formation sont des formateurs dès leur retour à la maison. Qui sont-ils ?
En réalité, nous les conservateurs, nous avons conduit des délégations constituées pour la plus part des communautés locales, des populations riveraines des aires protégées. Il est question de former ces personnes afin qu’elles aillent à leur tour répercuter cette formation aux autres membres de leurs communautés.
Combien de personnes ce projet ACREGIR va impacter au niveau du parc national de Waza ?
Notre souhait est que cette formation impacte tous les agriculteurs et les éleveurs qui sont autour du parc de Waza. #population #Produitsforestiers #Cameroun #Tourisme pic.twitter.com/21A7XcQlp6
— Momokana Augustin Ro (@ARMomokana) October 4, 2023
Notre souhait est que cette formation impacte tous les agriculteurs et les éleveurs qui sont autour du parc de Waza. Nous n’avons pas une limite à ça lorsque nous pensons que la population va embrasser l’offre. Néanmoins on s’est fixé un objectif de 1000 personnes. Mais notre vœu le plus cher est d’aller au-delà.
Quelle est la spécificité du parc de Waza à côté des autres dont le parc national de Kimi-Fungom ?
Le parc national de Waza c’est le fleuron du tourisme au Cameroun et voire dans la sous-région Afrique centrale. Le parc de Waza est le seul au Cameroun où l’activité touristique est très développée. Il est à vocation uniquement touristique, contrairement aux autres parcs nationaux où l’on pratique la chasse. Le parc de Waza n’a pas de zone cynégétique. Il est entièrement voué aux activités écotouristiques. Et sur ce point nous avons des animaux qui font son attractivité. Vous avez des grands pachydermes à l’instar de la girafe, de la damaris, de l’éléphant… c’est de grands pachydermes qui attirent les touristes. Il est différent parce qu’à des endroits c’est des steppes. Ce qui fait que vous pouvez avoir de la visibilité sur jusqu’à 2 kilomètres. Ainsi lorsque les animaux sortent pour brouter la strate graminéenne vous pouvez les observer à bonne échéance. C’est beau à voir !
Comment se porte le parc national de Waza à l’heure où l’insécurité inquiète dans l’Extrême-Nord ?
Nous avons quelques difficultés surtout liées à la longue saison sèche. Dans les 12 mois de l’année nous avons jusqu’à neuf mois de sécheresse. Et le parc de Waza, malheureusement, n’est traversé par le Logone qu’en bordure. A l’intérieur il y a des mares qui sont stagnantes et qui, pendant la saison sèche s’assèchent complètement. Cette sécheresse impose aux animaux de partir du parc vers l’extérieur, dans d’autres formations végétales à des distances, à travers des corridors, à la recherche de l’eau et d’autres ressources fourragères telles que le pâturage. Ce qui rend le contrôle de ces animaux devient assez difficile.
Parlons de l’impact de l’insécurité sur le parc de Waza.
Avec l’insécurité nous avons enregistré une baisse considérable des touristes. L’activité est aujourd’hui en berne. Mais nous pensons que les choses sont déjà entrain de rentrer dans l’ordre et nous pourrons dans les années à venir enregistrer plus de touristes qu’avant. Parce que le nombre de demandes commence déjà à grimper. Il devient de plus en plus important. Il est prévu de creuser et d’aménager des mares pour apporter des ressources hydriques pendant la saison sèche, afin d’empêcher les mouvements d’animaux.
Les animaux qui se déplacent à la recherche des pâturages ou des points d’eau font de longues distances et parfois reviennent très amochés, d’autres meurent pendant les déplacements. Ce n’est pas beau à voir dans le cas du tourisme qui voudrait qu’on ait des animaux bien portants, qui se meuvent bien, qui ont un beau corps pour satisfaire vraiment la curiosité du touriste.
Les animaux qui se déplacent à la recherche des pâturages ou des point d’eau font de longues distances et parfois reviennent très amochés, d’autres meurent pendant les déplacements. #population #Produitsforestiers #Cameroun #Tourisme #animaux pic.twitter.com/gIVqkKaTWf
— Momokana Augustin Ro (@ARMomokana) October 4, 2023
Quels sont les origines des touristes qui visitent le parc national de Waza ?
Ils sont des étrangers pour la plus part. Ils viennent de la Suisse, ils viennent de la France, ils viennent d’Allemagne, ils viennent des Etats-Unis, ils viennent également de la Turquie. L’activité écotouristique au plan national, il faut dire la vérité, n’a pas encore de clients. Les gens ont du mal à prendre leur congé pour aller découvrir ailleurs. Cela n’est pas un problème de moyen mais un problème culturel. Parce que les taxes que les nationaux payent sont très faibles par rapport à ceux imposés aux touristes étrangers.
Lorsque vous observez bien les populations alentours du parc, la résilience dont on parle peut-elle se concrétiser ? Ne serait-ce pas un discours politique ?
La résilience est un fait avéré. Dans la mesure où lorsqu’il y a changement climatique et qu’il y a de l’impact sur la production agricole des populations riveraines, ces dernières sont obligées de s’adapter. A ce titre les ONG, les institutions internationales, l’État ne peuvent faire autrement que de les accompagner dans leur résilience. L’année dernière, par exemple, au lieu de trois mois de pluies on en a eu deux mois et demi. Évidemment tout le monde s’est tourné vers le mil de contre-saison. Parce qu’on n’a pas eu une grande récolte des spéculations de la saison pluvieuse.
Le mil de contre-saison se développe avec le froid, en décembre lorsqu’il fait trop froid. Il faut que l’État travaille davantage sur les semences de courtes durées. C’est vrai que l’IRAD a mis à disposition des semences de maïs qui ne fait que trois mois. Mais il doit travailler beaucoup parce que le climat change, les populations s’adaptent, et il faut également que les semences s’adaptent.
Vous disiez hier que vous êtes content d’être en séjour à la maison.
Oui c’est une fierté lorsqu’une institution vous a donné toutes les compétences nécessaires, lesquelles lorsque vous les mettez en pratiques sur le terrain portent de grands et bons fruits… c’est la valeur de cette école-là qui est en nous. On est allé sur le terrain, mais on n’a pas oublié cette école qui nous a tout donné. Et lorsqu’on y revient comme ça et qu’on retrouve des enseignants qui nous ont formé c’est une grande joie. Je n’aurais pas dû venir à cause de mon calendrier trop surchargé, mais l’occasion ou l’idée de pouvoir rencontrer mes enseignants a été décisive car il s’agissait une occasion exceptionnelle pour moi de les revoir dans ces lieux qui m’a accueilli, m’a transformé pour que je devienne celui que je suis aujourd’hui. J’ai vu le professeur Martin Tchamba qui n’est pas un petit dans le domaine de la biodiversité. Il avait d’abord travaillé à WWF où il a donné tout de ses compétences. J’ai rencontré le professeur TANKA Christopher par hasard. Il est climatologue et il m’a donné ce cours-là en anglais. C’est d’ailleurs lui qui m’a permis de comprendre un cours en anglais. Il sortait fraichement des Etats-Unis et il s’exprimait dans une langue parfaite. Je suis sûr qu’il ne se rappelle plus de moi, mais j’avais validé son unité d’enseignement avec 19/20. J’avais rédigé en anglais alors que j’étais francophone. Il y a Eric Chrétien que j’ai rencontré hier et j’étais très content qu’il m’appelle par mon nom. Cela prouve que les enseignants eux aussi n’oublient pas leurs étudiants qui excellent.
Propos recueillis par Augustin Roger MOMOKANA